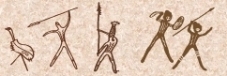
Les
gabonais appartiennent au groupe linguistique bantou
(exceptés les Pygmées). Les Bantous, 120.000.000 d’âmes
en Afrique, vivent dans le centre et le sud du continent à partir
d’une ligne allant de Douala (Cameroun) à Mombasa (Kenya).
Les Bantous sont arrivés au Gabon à une date encore mal
déterminée, entre le XI° et le XII° siécle; leur migration
s'est poursuivie jusqu'au XIX° siècle avec l'arrivé des
Fangs. S’il n’existe pas d’unité ethnique(le Gabon à lui
seul compte 45 ethnies par exemple), il n’en reste pas
moins que la parenté entre les langues bantoues, parlées
dans toute l’Afrique subsaharienne, est indéniable.
Cette parenté témoigne de l’existence d’une langue
et d’un foyer communs originels.
C’est au début de l’ère chrétienne qu’une civilisation
d’agriculteurs maîtrisant la métallurgie commencent à émigrer vers l’est et le
sud, submergeant les populations autochtones de Pygmées et de Bochimans qui vivaient
encore dans une économie de l’âge de pierre. L’ethologue américain Murdock a
situé foyer originel des Bantous au moyen Niger, qui a peut-être été la base
de repli de la civilisation très avancée et ancienne du Sahara quand il était
encore une étendue de savanes.Sembleraient en témoigner les peintures rupestres
du Tassili qui sont, à l’évidence, des réalisations d’hommes de race noire, grands
et élancés.
Si cette hypothèse était admise, elle supposerait
que ces " Proto-Bantous " avaient été les fondateurs de la brillante civilisation
de l’Egypte pharaonique. Mais il est possible que ces premiers sahariens aient été des
Nilotiques. Et, pour l’essentiel, l’accord se fait pour considérer le foyer camerounais
comme point de départ des migrations bantoues. Le deuxième foyer est le plateau
des Grands Lacs et correspond à toute la durée du Moyen-Âge en Europe. Les Bantous
ont longé la lisière nord de la grande forêt, l’ont contournée grâce au plateau
des Grands Lacs avant de déferler à nouveau vers le sud et l’ouest. Les groupes
les plus méridionaux, les Xhosas et les Zoulous à l’est, et les Herreros à l’ouest,
ne s’étant installés que vers les XV° et XVI° siècles.Ce n’est donc qu’assez
tardivement que les Bantous se sont établis dans la grande forêt, après l’introduction
de l’igname et de la banane plantain, venus d’Asie par la côte de l’Océan Indien.
Les trois types de civilisations bantoues
Ces différentes phases de migration ont engendré trois
types de civilisations bantoues:
1°) la civilisation des clairières des Bantous équatoriaux
de la grande forêt, organisés en petits groupes.
2°) la civilisation des greniers des Bantous
centraux a donné au Moyen-Âge africain ses plus puissants royaumes, à la lisière
de la grande forêt(Kongo, Luba, Lunda).
3°) la civilisation de la lance des Bantous méridionaux
qui étaient des pasteurs guerriers ;chez eux, l’art de la guerre et la discipline
martiale ont donné lieu aux grandes conquêtes zouloues dont Shaka demeure à jamais
la figure historique emblématique.Son génie militaire (et celui de ses successeurs)
a longtemps tenu en échec la pénétration européenne dans cette partie de l’Afrique
;elle marqua le coup d’arrêt de l’expansion bantoue à travers l'Afrique.
Au-delà de la diversité ethnique, il existe une
véritable unité culturelle entre les peuples du Gabon, majoritairement issus
du groupe bantou. Cette unité se reflète notamment dans les rites qui, bien que
pluraux, remplissent une même fonction de représentation sociale, de vision du
monde, d’initiation et de thérapie du corps et de l’âme.
A côté du bwiti, sans doute la pratique ésotérique
la plus connue en dehors des frontières du Gabon, il existe le ndjobi des obambas
et des téké. Ces rites révèlent toute la richesse des traditions du Gabon, un
patrimoine qu’il importe de protéger car il est le témoin de notre génie, de
notre histoire et de notre identité profonde. En définitive, il est la meilleure
part de nous-mêmes, celle que nous pouvons offrir à la gloire de la civilisation
universelle. C’est notre contribution dans le nécessaire dialogue des cultures
et des civilisations. C’est aussi la meilleure de résistance aux tentatives d’uniformisation
du monde qu’une certaine conception de la globalisation veut nous imposer.
Au coeur des rites du Gabon: le bwiti....
Le bwiti est intimement lié à la plante iboga,
mondialement connue. Elle est le véhicule initiatique de ce rite. L’iboga produit
deux effets en fonction du dosage et de la finalité initiatique.
1) A petites doses, l’iboga a des effets simplement
toniques.
2) A plus fortes doses, il entraîne l’initié dans
des visions initiatiques.
Les finalités de l’initiation sont multiples :il
s’agit d’une part de projeter l’initié dans la dimension de l’origine des temps,
de sorte qu’il revive les souvenirs et le cheminement des milliers de générations
qui l’ont précédé dans la chaîne de l’existence. Le bwiti part de l’idée que
nous recevons ces souvenirs en legs, de sorte que chaque mémoire individuelle
est une parcelle de la mémoire collective et immémoriale de la société. Le bwiti
fonctionne donc comme une « constitution sociale », en tant qu’il invite chacun à perpétuer
l’unité de la société, à en respecter les règles et les principes fondateurs.
Le bwiti est aussi une école et une expérience de l’humilité :l’initié doit s’incliner
devant la grandeur de l’oeuvre des anciens et prendre conscience qu’ « un seul
doigt ne peut jamais laver la figure ».
D’autre part, le bwiti a une fonction curative.
La connaissance des plantes médicinales est un autre aspect de l’arsenal des
grands initiés. La maladie du corps ou de l’âme est perçue comme une rupture
de l’harmonie entre l’homme et les éléments. Cela peut résulter de la transgression
d’une loi du groupe ou de la nature, d’une négligence dans l’observation du culte
aux ancêtres ou même d’une malveillance humaine. Le pouvoir de guérison du bwiti
va permettre de rétablir cette harmonie, de réconcilier l’homme avec les ancêtres
et d’anéantir les mauvais sorts. L’efficacité de l’ibogaïne et de ses dérivés
a été attesté scientifiquement, notamment dans le traitement des personnes dépendantes
des drogues dures. Les scientifiques affirment avoir obtenu avec l’ibogaïne plus
de résultats satisfaisants dans le sevrage des toxicomanes qu’avec les méthodes
utilisées jusqu’alors et que l’ibogaïne elle-même n’entraîne aucune accoutumance.

